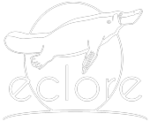De la peinture aux pixels, à 73 ans
Au « secret des secrets », nous dit un poème de Jean Janoir (1929-2012), nous n’aurons jamais accès. C’est pourtant ce que va tenter Janoir, une vie à peindre en retraçant le parcours atypique de cet homme qui, à l’âge de 73 ans, a décidé de continuer sa peinture par ordinateur, maîtrisant les brosses de Photoshop comme les pinceaux d’hier. C’est par nécessité qu’il s’est ainsi métamorphosé : en 1995, une grave opération l’avait obligé à rester le plus souvent assis. Malgré la mort, malgré la maladie qui l’empêchait de peindre debout, de danser devant ses toiles, Jean Janoir a continué à être acteur et auteur de son œuvre grâce au numérique.
- Réalisation : Émilie Souillot et Jérémy Zucchi, 2013.
- Production : JPL Productions et Cinaps TV avec le soutien du CNC.
- 53 minutes, 2013

Projections du film
Ce film peut-être librement projeté, dans un but non-commercial exclusivement, lors d’évènements gratuits, ainsi que dans un cadre pédagogique ou périscolaire. Pour cela, envoyez un mail à contact [@] eclorecreations.com
Synopsis
Le peintre était comme un arbre solide dont les branches repoussent sans cesse, explorant les possibles pour s’épanouir. Janoir semblait pouvoir sans cesse se métamorphoser pour passer d’un support à l’autre, tout en restant lui-même ; il semblait avoir la force de toujours se relever. Il fut guitariste de jazz, peintre avec des brosses réelles ou virtuelles, concepteur de décors et de costumes d’opéras, sculpteur, designer d’intérieur, poète.

Janoir, une vie à peindre raconte la vie d’un homme qui a fait le choix de vivre dans son art, qui a accédé à une certaine notoriété grâce à ses costumes et décors d’opéras, a réalisé d’immenses toiles de commande, avant que le temps passe et le vent tourne ; il s’est replié chez lui puis a sombré dans l’oubli. Jean Janoir et son épouse Michelle Bouix sont morts tous les deux au début de l’année 2012. Les œuvres et leurs biens ont été vendus et dispersés à bas prix lors d’une vente judiciaire en octobre.
C’est l’histoire d’une renaissance de soi-même, par l’art qui transmet l’espoir fou de toujours rester en vie… Ce n’est pas seulement un documentaire sur la vie et l’œuvre d’un peintre, mais le portrait de deux amis, décédés à un mois et demi d’intervalle. En effet, depuis qu’Émilie Souillot réalisa Histoire (s) de Jazz, le Hot Club de Lyon (52 minutes, 2009) sur le club de jazz dont Janoir fut un des musiciens fondateurs, les réalisateurs de Janoir, une vie à peindre étaient devenus les « petits-enfants de cœur » de Jean et de Michelle, comme cette dernière aimait les présenter.
Le portrait d’un artiste tel que Jean Janoir aurait pu servir de base à une analyse du déplacement de l’œuvre vers le virtuel, ou à une histoire du processus de décentralisation culturel à Lyon au cours des années soixante, mais ce film est surtout le cri étouffé d’un vieil homme malade, retranscrit par une jeune femme et un jeune homme. C’est pourtant un film rempli d’espoir, malgré la certitude de la mort, ses réalisateurs n’ayant pas souhaité faire de leur film un éloge funèbre, mais une exaltation de la vie qui déborde des œuvres de Jean Janoir et du sourire de son épouse Michelle.
Générique
- Production : JPL Production et Cinaps TV avec le soutien du CNC
- Réalisation : Émilie Souillot et Jérémy Zucchi
- Avec Jean Janoir, Michelle Janoir, Pierre Arrivetz, Jean-Jacques Lerrant, Régis Neyret, Jacques Ray, Damien Voutay…
- Musique : Émilie Souillot (piano), Élodie Poirier (violoncelle et nickelharpa) et Jérôme Bodon-Clair (guitare)
- Image et son : Émilie Souillot et Nicolas Folliet
- Montage : Pierre-Louis Vine
- Enregistrement de la musique : Benoît Bel, studio Mikrokosm
- Moyens Techniques : Cinaps TV / Jeudi 15
- Chargé de production : Yoann Nurier
- Producteur délégué : Jean Pierre Lagrange
- HD – Durée 52 min – Son stéréo – Couleurs, 16/9 – 2013
Musique du film

Créer la musique d’un film documentaire
Compte tenu de son importance de la musique dans la vie de Jean Janoir, guitariste de jazz dans sa jeunesse, la musique a revêtu une importance plus grande que pour un autre film documentaire. La présence de la femme en robe rouge dans Janoir, une vie à peindre nous a permis de proposer des échappées mentales et lyriques où la musique peut s’élever et s’étendre, à la différence des entretiens où elle est soit absente, soit en retrait. Nous imaginions une musique en permanente évolution, force en mouvement qui se métamorphose.
Écriture et improvisation
La conception de la musique a reposé sur un mélange d’écriture préalable et d’invention au moment de l’enregistrement (certains morceaux, tel le Lumineux tango ci-dessous, ont été entièrement improvisés). La co-réalisatrice de Janoir, une vie à peindre, Émilie Souillot, a composé et interprété les parties au piano, tandis qu’Élodie Poirier (violoncelle et nickelharpa) et Jérôme Bodon-Clair (guitare) ont improvisé les lignes de leurs instruments. Le trio n’avait jamais joué tous les trois ensemble avant le jour de l’enregistrement. Ce dernier a duré une seule journée, mais « avec Élodie, à force d’improviser sur ce qui était déjà existant, on a pu se laisser aller » explique Émilie. Certains morceaux ont été joués en respectant un minutage précis, ayant été conçus pour des séquences spécifiques, déjà montées, tandis que d’autres ont été enregistrés librement, comme un fil de notes pouvant être librement cousu dans la trame du montage, selon nos besoins.
La musique a été enregistrée par Benoït Bel dans son Mikrokosm Recording Studio, à Villeurbanne. C’est brut, enregistré d’un seul trait, sans mixage ultérieur faute de temps. Nous tenions de toutes façons à conserver un son proche du live, rappelant celui des sessions de jazz enregistrées en commun autrefois. Nous tenions aussi à faire entendre la rudesse archaïque du nickelharpa (instrument traditionnel suédois), confronté à l’ampleur du violoncelle, à l’intimité du piano, à la nonchalance énergique d’une guitare électrique jouée façon blues.
Quel espace pour la musique ?
Jeunes réalisateurs désireux de célébrer l’art et la vie de nos amis Jean et Michelle à l’écran, nous avions imaginé un dispositif où la musique aurait disposé d’une place plus grande encore, par une mise en scène de la femme en robe rouge chantant et dansant sur scène, comme Michelle avait dansé pour Jean au Hot Club de Lyon dans leur jeunesse. Nous désirions mettre en scène la création de la musique du film comme un moment de vie improvisée sur la scène du Hot Club, mêlant les univers musicaux de différents musiciens. La musique aurait été jouée derrière des projections des œuvres de Janoir sur une surface en tulle, les musiciens pouvant ainsi émerger de ces images puis disparaître tels des fantômes hantant les peintures.
Nous imaginions trop de choses pour un documentaire au format ne pouvant dépasser 52 minutes (case télévisuelle oblige)… Être réalisateur, c’est faire les choix les plus justes possibles en fonction de l’histoire racontée, et être capable de renoncer à ses envies si elles ne peuvent s’intégrer harmonieusement dans le récit du film. Nous avons donc rangé dans le tiroir de nos idées ce lourd dispositif, et adopté une forme plus pertinente. Nous n’avons pas pour autant remisé notre désir de créer une musique conçue spécialement pour le film. Le plaisir de créer la bande originale de Janoir, une vie à peindre a été à la hauteur de nos ambitions un peu folles !
Émilie Souillot et Jérémy Zucchi
Événements
 En partenariat avec l’association Eclore, la mairie du 2ème arrondissement de Lyon a organisé une exposition rétrospective de l’œuvre de Jean Janoir du 4 au 15 novembre 2013. Le film Janoir, une vie à peindre est projeté pour la première fois le soir du vernissage. Les contributeurs de cette exposition (les galeristes Jean-Louis Mandon et Damien Voutay ainsi que des amis de Jean et Michelle Janoir) ont offert au public l’occasion de découvrir une vingtaine de toiles (peintures à l’huiles et numériques), permettant d’appréhender son œuvre dans sa continuité. Une projection pour des étudiants en arts a par ailleurs été proposée quelques jours plus tard.
En partenariat avec l’association Eclore, la mairie du 2ème arrondissement de Lyon a organisé une exposition rétrospective de l’œuvre de Jean Janoir du 4 au 15 novembre 2013. Le film Janoir, une vie à peindre est projeté pour la première fois le soir du vernissage. Les contributeurs de cette exposition (les galeristes Jean-Louis Mandon et Damien Voutay ainsi que des amis de Jean et Michelle Janoir) ont offert au public l’occasion de découvrir une vingtaine de toiles (peintures à l’huiles et numériques), permettant d’appréhender son œuvre dans sa continuité. Une projection pour des étudiants en arts a par ailleurs été proposée quelques jours plus tard.
Le 16 mars 2014, le film Janoir, une vie à peindre est projeté à la Galerie Jean-Louis Mandon (Lyon) dans le cadre d’une exposition de peintures à l’huile de Jean Janoir et Pierre Montheillet (du 11 au 30 mars 2014). Depuis, le film poursuit son existence, faisant découvrir l’œuvre de Janoir à un public restreint mais touché par ses formes, sa force, son histoire. Les événements proposant projection et exposition permettent aux spectateurs de mieux comprendre les enjeux des œuvres exposées grâce à l’éclairage apporté par le film. C’est toujours l’occasion d’une rencontre entre l’œuvre et le public.
Presse
 Article publié dans Le Progrès (Lyon), le 11 novembre 2013.
Article publié dans Le Progrès (Lyon), le 11 novembre 2013.